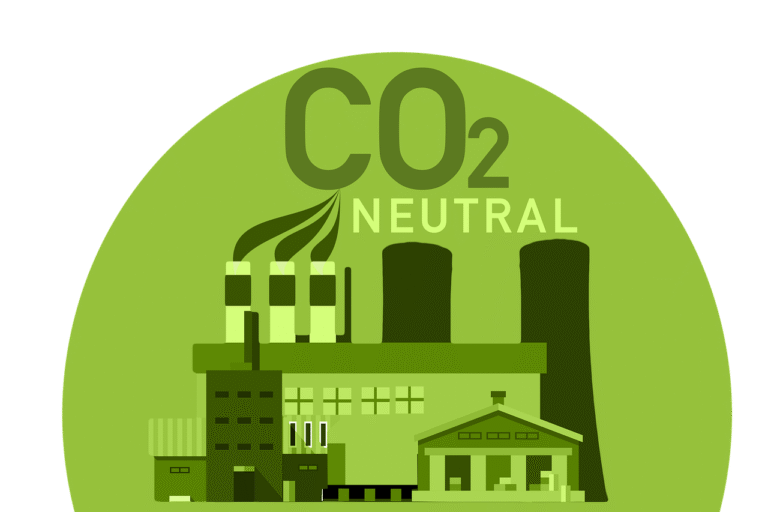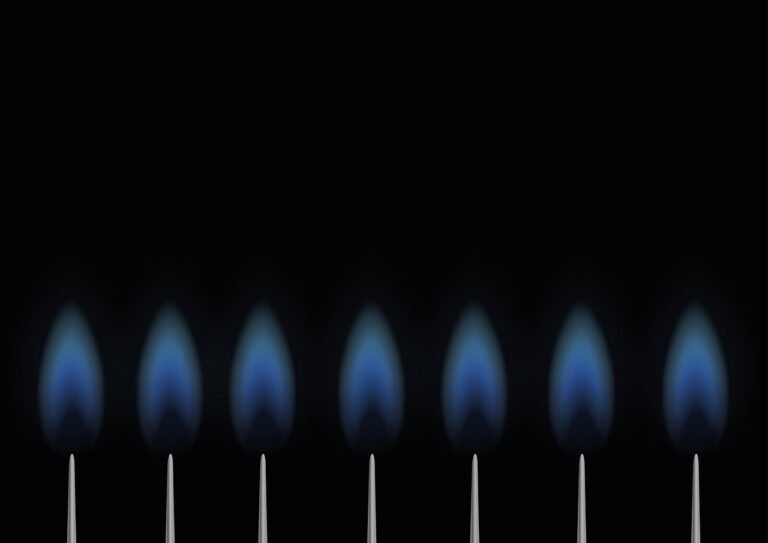|
EN BREF
|
En janvier 2025, une mise à jour de l’étude portée par l’ADEME et l’Arcep a enrichi les données de 2022, prenant en compte les usages numériques français hébergés à l’étranger et l’empreinte carbone des centres de données. En 2020, 79 % de l’empreinte carbone du numérique est attribuée aux équipements des utilisateurs, avec une production matérielle représentant près de 80 % des émissions avant même leur utilisation. Les résultats prévoient que sans intervention, l’impact environnemental pourrait tripler d’ici 2050. Trois scénarios prospectifs pour 2030 identifient des leviers d’action, notamment l’éco-conception et la sobriété numérique, permettant de réduire de manière significative l’empreinte environnementale. À horizon 2050, les différents scénarios témoignent d’impacts variés selon les choix sociétaux, mettant en exergue la nécessité d’une réponse collective pour atteindre la neutralité carbone.
L’étude menée par l’ADEME et l’Arcep permet de mieux comprendre les impacts environnementaux du numérique, un sujet qui prend de plus en plus d’importance compte tenu des défis écologiques actuels. Cet article propose une analyse approfondie des résultats de cette étude, en se concentrant sur l’état des lieux en 2020, les projections pour 2030 et les perspectives jusqu’en 2050. Nous y examinerons notamment l’empreinte carbone des équipements numériques, leur fabrication et leur durée de vie, ainsi que les leviers à actionner pour réduire leur impact sur l’environnement.
Etat des lieux en 2020 : nos équipements et leur durée de vie, premiers responsables de l’empreinte environnementale du numérique
En 2020, la transition numérique s’est affirmée comme un moteur de changement dans notre façon de communiquer, de travailler et de vivre. Toutefois, ce développement rapide du numérique s’accompagne d’une empreinte environnementale considérable. La fabrication des équipements numériques tels que smartphones, téléviseurs et ordinateurs génère 79% de l’empreinte carbone du numérique. Cette étude montre que la consommation des utilisateurs n’est responsable que de 20% des émissions, mettant ainsi en lumière l’impact de la production initiale de ces appareils.
Environ 300 kilos de déchets par personne sont générés en France pour les seuls usages numériques, ce qui est alarmant compte tenu des ressources nécessaires à la fabrication de ces équipements. La recherche sur les méthodes d’écoconception et de recyclage devient alors cruciale pour répondre aux enjeux de durabilité. De plus, la courte durée de vie de certains équipements, comme les smartphones et tablettes, qui ne dépassent souvent pas deux à trois ans, accentue le besoin d’amélioration des cycles de vie par le reconditionnement et la réparation.
Sans action pour limiter la croissance de l’impact environnemental du numérique, son empreinte carbone pourrait tripler entre 2020 et 2050
Les projections jusqu’en 2050 présentées par l’ADEME et l’Arcep sont alarmantes. Elles estiment que, sans mesures ambitieuses, l’empreinte carbone du secteur numérique pourrait tripler d’ici 2050. Ces augmentations inquiétantes sont liées à la croissance continue des usages numériques et au développement des infrastructures de stockage, comme les centres de données.
Le scénario de référence, connu sous le nom de « tendanciel », repose sur l’hypothèse que les tendances observées, tant à la hausse qu’à la baisse, se poursuivront. Cela signifie qu’une forte augmentation de l’impact environnemental pourrait être le résultat de la combinaison de l’augmentation des usages et de l’inefficacité énergétique des équipements et infrastructures existants.
Pour réduire l’impact environnemental du numérique dès 2030, des leviers d’action sont identifiés
Pour atténuer cette crise numérique, l’étude propose plusieurs leviers d’action. En 2030, des scénarios alternatifs à celui de la tendance actuelle pourraient permettre de réduire significativement l’impact environnemental. L’accent est mis sur l’importance de l’éco-conception, qui implique de repenser le cycle de vie des produits numériques dès leur conception.
Il est suggéré d’allonger la durée de vie des équipements et d’encourager l’utilisation de solutions reconditionnées. Les consommateurs doivent également être sensibilisés à des pratiques de consommation numérique plus durables. Des actions collectives, impliquant fabricants, utilisateurs et gestionnaires de réseaux, sont essentielles pour évoluer vers une économie plus verte. L’émergence d’une sobriété numérique pourrait, via des choix éclairés d’équipement et la réduction de l’utilisation énergétique, entraîner des résultats positifs.
A horizon 2050 : des impacts très variables selon les scénarios retenus
Les auteurs de l’étude ADEME-Arcep ont également développé quatre scénarios prospectifs pour 2050, chacun mettant l’accent sur des choix de société très différents. Le premier scénario, la “Génération Frugale”, vise des transformations majeures dans les modes de consommation, incitant à la sobriété et à l’usage responsable des ressources. D’un autre côté, le scénario « Technologies vertes » mise sur le développement technologique pour compenser les impacts environnementaux.
Ces divers scénarios montrent que l’impact du numérique sur l’environnement peut être fortement corrélé à nos choix collectifs. Il apparaît donc crucial d’encourager des comportements responsables pour réduire cette empreinte et viser une transition vers un numérique durable d’ici 2050.
Les résultats des travaux de l’ADEME et de l’Arcep posent la question fondamentale de la durabilité de nos pratiques numériques actuelles. Sans une prise de conscience collective et des actions concrètes, les conséquences sur l’environnement pourraient être dramatiques. En redéfinissant nos usages et en adoptant des pratiques durables, il est possible de construire un avenir où le numérique et la protection de notre planète avancent de concert.

La transition numérique s’accompagne d’une empreinte environnementale croissante, comme le souligne l’étude conjointe menée par l’ADEME et l’Arcep. En 2020, l’analyse indique que 79 % de l’empreinte carbone du numérique provient de la fabrication de nos équipements, tels que smartphones et ordinateurs. Ce constat rappelle l’importance de la chaîne de production dans la lutte contre le changement climatique.
Dans cette même étude, il est révélé que la durée de vie moyenne des équipements est alarmante, avec seulement 2,5 ans pour un smartphone. Cette courte durée d’utilisation accentue l’impact environnemental, car la majorité des émissions de gaz à effet de serre surviennent avant même que l’utilisateur ne prenne possession de l’appareil. Par conséquent, les efforts doivent être concentrés sur l’allongement de cette durée de vie pour réduire l’empreinte carbone totale.
En se projetant vers 2030, les scénarios étudiés montrent qu’en l’absence de mesures concrètes, l’empreinte carbone du numérique pourrait tripler d’ici à 2050. Les données révèlent que nous devons agir maintenant, en intégrant des pratiques telles que l’éco-conception et la sobriété numérique, afin de limiter cette augmentation. Cela inclut la conception de terminaux plus durables et l’adoption de comportements de consommation plus responsables.
Les simulations indiquent également que si rien n’est fait pour modifier nos habitudes, les émissions de gaz à effet de serre du numérique pourraient augmenter de 45 % à horizon 2030 et de 187 % à horizon 2050. Ces chiffres témoignent de l’urgence à repenser notre rapport aux technologies numériques et à intégrer des solutions innovantes pour atténuer cet impact.
Les parties prenantes, incluant fabricants, opérateurs et utilisateurs, doivent collaborer pour adopter une approche systémique. Le défi est de trouver des solutions durables, qu’il s’agisse de promouvoir des pratiques d’utilisation sobres ou d’améliorer l’efficacité énergétique des équipements et infrastructures numériques. Chaque acteur a un rôle à jouer pour répondre aux enjeux environnementaux majeurs posés par le numérique.