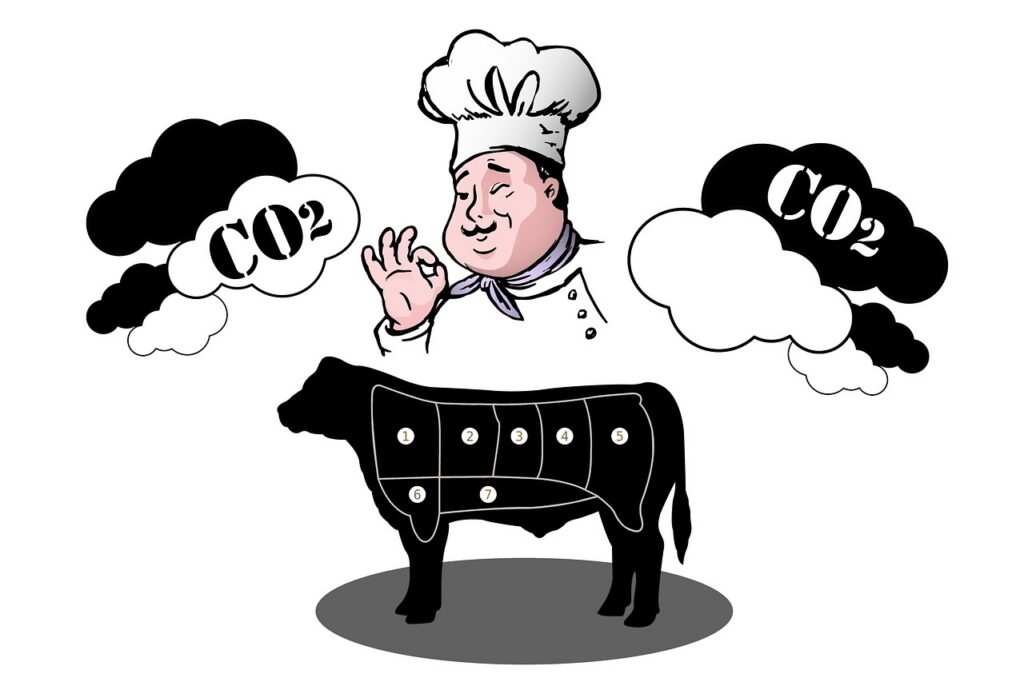
|
EN BREF
|
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se distinguent par leur empreinte carbone réduite, évaluée à 2,085 millions de tonnes de CO2, un bilan bien meilleur que celui de leurs prédécesseurs, tels que Londres 2012 et Rio 2016. Cette performance est en partie attribuée aux choix stratégiques de la France, favorisant la réutilisation d’équipements existants et la construction d’infrastructures durables. En effet, 65 % des émissions proviennent des déménagements et hébergements des spectateurs, tandis que la moitié de l’empreinte carbone totale est causée par les déplacements des spectateurs étrangers. Ainsi, Paris 2024 se positionne en leader en matière d’impact environnemental dans le cadre des Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s’annoncent comme un événement marquant non seulement sur le plan sportif, mais également en matière de responsabilité environnementale. Avec un bilan carbone estimé à 2,085 millions de tonnes de CO2, la France vise à établir un nouveau standard pour les grands événements sportifs. Cet article explore la manière dont Paris 2024 a réussi à diminuer son empreinte carbone par rapport aux éditions passées, tout en mettant en avant les stratégies adoptées et leur impact.
L’empreinte carbone des jeux olympiques précédents
Pour mieux appréhender les progrès réalisés par Paris 2024, il est essentiel de jeter un œil sur les empreintes carbone des éditions précédentes. Par exemple, les Jeux Olympiques de Londres 2012 ont généré 3,3 millions de tonnes de CO2, tandis que ceux de Rio 2016 ont atteint 4,5 millions de tonnes. En comparaison, les Jeux de Tokyo 2020 affichent une empreinte de 2 millions de tonnes, mais cela est en partie dû à l’absence de spectateurs étrangers à cause de la pandémie. Ainsi, Paris 2024 se positionne comme l’un des événements les moins polluants de l’histoire des JO, prouvant que la durabilité peut coexister avec l’excellence sportive.
Les sources des émissions de gaz à effet de serre à Paris 2024
Lorsqu’il s’agit de comprendre l’empreinte carbone des Jeux de Paris, il est crucial d’analyser les sources des émissions. Selon les données, une part significative de ces émissions, soit 65 %, provient principalement des déplacements et de l’hébergement des spectateurs, accrédités et délégations. Les infrastructures durables, telles que le village olympique et le centre aquatique, représentent 19 % des émissions, tandis que les installations temporaires, dont la logistique et la restauration, constituent 16 % du total des émissions.
Les déplacements : un facteur clé
Les déplacements à longue distance des spectateurs jouent un rôle déterminant dans l’empreinte carbone des Jeux. En effet, 50 % de l’empreinte totale des Jeux proviennent des voyages des spectateurs étrangers. Parmi eux, les spectateurs extra-européens, qui ne représentent que 9 % du total des spectateurs, émettent à eux seuls 80 % des gaz à effet de serre liés au transport, avec une émission moyenne d’environ 2,14 tonnes de CO2 équivalent par spectateur. À l’inverse, un spectateur européen émet seulement 0,2 tonnes de CO2 équivalent.
Des choix structurants pour réduire l’empreinte carbone
La France a mis en place plusieurs choix stratégiques afin de réduire efficacement les émissions de carbone des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un des objectifs principaux a été la réutilisation d’équipements existants. Par exemple, plutôt que de construire de nouvelles infrastructures coûteuses et polluantes, Paris a opté pour la transformation et l’adaptation des installations existantes. Cela a permis de minimiser les nouvelles constructions et, par conséquent, de réduire les émissions associées.
En outre, certaines nouvelles installations ont été conçues pour répondre à des besoins locaux et pour apporter des bénéfices durables après l’événement. À Saint-Denis, par exemple, le village olympique sera reconverti en logements, répondant ainsi à un besoin crucial de la région. Ces décisions garantissent que les investissements réalisés pour les Jeux auront des retombées bénéfiques pour les communautés locales, devenant ainsi un modèle de durabilité.
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne sont pas une simple compétition sportives, ils représentent également une occasion de promouvoir la durabilité et de revoir les pratiques de l’événementiel. Avec l’accent mis sur le développement durable, les organisateurs souhaitent démontrer que des événements d’envergure peuvent être conçus avec un respect accru pour l’environnement.
En effet, les efforts déployés par Paris 2024 servent d’exemple à d’autres villes et pays qui accueillent des manifestations à grande échelle. La prise de conscience et l’intégration de pratiques durables dans la planification des événements de cette ampleur pourraient influencer le secteur dans son ensemble. En favorisant une approche réduisant l’empreinte écologique, Paris 2024 pourrait devenir un catalyseur pour des changements durables au sein de l’événementiel sportif.
Les attentes des spectateurs et des athlètes
Les athlètes et les spectateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus conscients des questions environnementales. L’attente d’un événement respectueux de l’environnement est désormais une norme plutôt qu’une exception. Les futurs spectateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 sont impatients de participer à une célébration du sport qui honore à la fois la performance et la responsabilité environnementale. Les athlètes, quant à eux, portent souvent des comportements et des valeurs écologiques, ce qui donne davantage de poids à l’engagement en faveur de la durabilité.
Une leçon pour le futur
Le travail réalisé pour réduire l’empreinte carbone des Jeux Olympiques de Paris 2024 pourrait inspirer les futures éditions et d’autres événements similaires. En tant que pionniers dans l’intégration de la durabilité dans le secteur sportif, Paris 2024 posent les bases d’une transformation majeure dans la manière dont sont perçus et organisés de tels événements.
Les défis à relever
Malgré les avancées notables, le chemin vers une empreinte carbone véritablement nulle reste semé d’embûches. Les organisateurs devront surmonter des défis variés, notamment en ce qui concerne la gestion des déplacements à longue distance et la sensibilisation des participants à adopter des pratiques plus durables. La collaboration et l’engagement au niveau local et international seront également cruciaux pour réussir cette démarche.
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent une réelle opportunité pour démontrer que le sport et la préservation de l’environnement peuvent aller de pair. En visant à réduire leur empreinte carbone et à intégrer des pratiques durables dans chaque aspect de l’événement, Paris 2024 ouvrent la voie à des jeux plus écologiques.
Pour en savoir plus sur les différentes initiatives de durabilité et sur l’impact environnemental des événements, vous pouvez visiter les liens suivants :
en savoir plus sur les initiatives climatiques,
comme le bilan carbone des JO de Paris,
ou encore
l’impact des choix stratégiques pour un bilan carbone allégé.

Témoignages sur Paris 2024 : Vers des Jeux Olympiques à l’empreinte carbone allégée
Il y a un an, les yeux du monde entier étaient rivés sur Paris pour l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques. Ce moment historique a été l’occasion de mesurer l’impact environnemental d’un événement d’une telle envergure. Avec un bilan carbone de 2,085 millions de tonnes d’équivalent CO2, Paris 2024 se distingue comme l’une des éditions les moins polluantes de ces dix dernières années.
Les résultats d’une étude commandée par le Commissariat général au développement durable révèlent que cette empreinte carbone est bien inférieure à celle de ses prédécesseurs tels que Londres 2012, qui affichait 3,3 millions de tonnes, ou encore Rio 2016, avec 4,5 millions de tonnes. À titre de comparaison, Paris 2024 est également en ligne avec Tokyo 2020, qui avait enregistré 2 millions de tonnes durant une édition sans spectateurs étrangers à cause de la pandémie.
Ce qui a principalement contribué à ces émissions de gaz à effet de serre lors des Jeux, c’est la mobilité. En effet, environ 65 % des émissions proviennent des déplacements et hébergements des spectateurs, des personnes accréditées et des délégations. Par ailleurs, 19 % des émissions sont liées à la construction d’infrastructures durables telles que le centre aquatique et le village olympique, tandis que 16 % concernent les installations temporaires.
Il est également intéressant de noter que la moitié de l’empreinte totale est attribuée aux déplacements des spectateurs étrangers. Les déplacements longue distance pèsent particulièrement lourd, car 9 % des spectateurs venant de l’extérieur de l’Europe génèrent 80 % des émissions de transport.
Les décisions stratégiques prises par la France ont permis cette diminution des émissions. En choisissant de réutiliser des équipements existants et de limiter les nouvelles constructions, Paris 2024 se positionne comme un modèle de gestion responsable. Les nouvelles installations, pensées pour servir véritablement la communauté locale, comme le village à Saint-Denis qui sera transformé en logements, témoignent d’un engagement fort envers un avenir plus durable.
Ces choix ont permis à Paris 2024 d’obtenir symboliquement la médaille d’or climatique, illustrant ainsi un tournant vers des manifestations sportives plus respectueuses de notre environnement.







