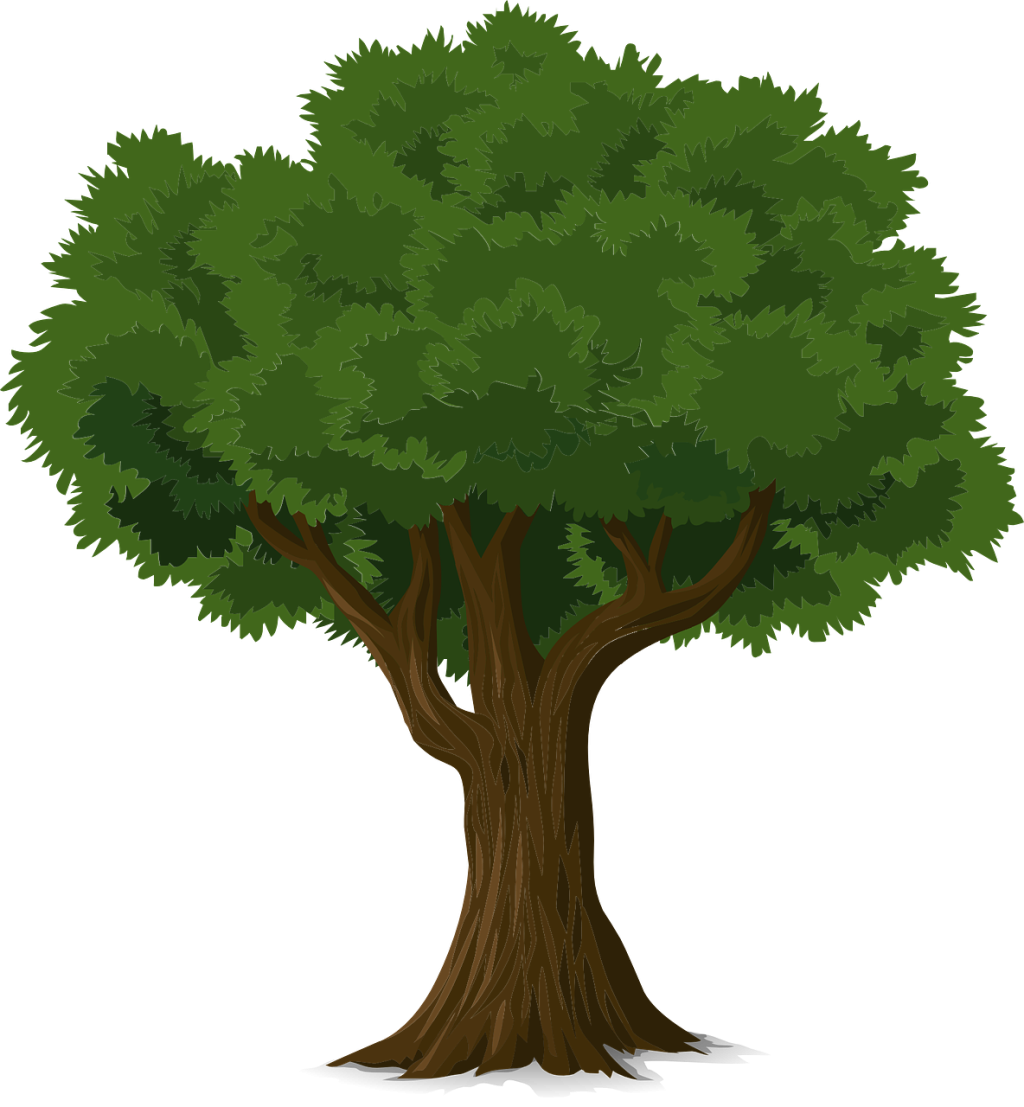
|
EN BREF
|
La question de la conciliation entre la transition numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) et les enjeux écologiques est de plus en plus pertinente. Alors que le numérique transforme profondément les pratiques éducatives et de recherche, des préoccupations émergent autour de son empreinte environnementale. La numérisation des établissements d’enseignement supérieur offre de nombreux avantages, mais elle s’accompagne également de consommation énergétique importante, notamment liée aux data centers et à la fabrication des équipements informatiques. Il est donc essentiel d’évaluer les impacts environnementaux de cette transition, tout en mettant en œuvre des solutions écoresponsables. Des initiatives émergent dans le secteur pour réduire ces impacts, intégrant des pratiques durables dans les formations et favorisant la mutualisation des ressources informatiques. L’enjeu est de tirer parti des avancées numériques tout en respectant les impératifs écologiques dans un contexte en constante évolution.
La question de la compatibilité entre la transition numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) et les enjeux écologiques est devenue cruciale à l’heure où les avancées technologiques se multiplient. Tandis que le numérique transforme les modes d’enseignement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer son impact environnemental. Cet article explore les différentes facettes de cette tension entre innovation et durabilité, en examinant les effets positifs et négatifs de la numérisation, ainsi que les stratégies mises en place pour promouvoir une approche écoresponsable.
Les effets du numérique sur l’enseignement supérieur
Depuis les années 1980, le numérique a eu un impact transformateur sur les établissements d’enseignement supérieur. Les universités et les écoles de recherche se sont progressivement adaptées à des systèmes d’information gérés par la technologie. Cela a permis une meilleure organisation des données relatives à la scolarité, aux ressources humaines et financières, et à la recherche. Les étudiants ainsi que le personnel font actuellement un usage quotidien des plateformes numériques pour le travail collaboratif et l’apprentissage.
Les avancées technologiques, telles que l’usage croissant des intelligences artificielles génératives, soulèvent cependant des interrogations quant à la durabilité de cette transition numérique. Les infrastructures de calcul et de stockage nécessaires à ces technologies consomment des quantités d’énergie considérables et génèrent une empreinte carbone négative. Il est donc essentiel de questionner le modèle dans lequel ces technologies sont utilisées afin d’en minimiser les impacts.
Les impacts écologiques du numérique
Les impacts environnementaux du numérique sont de plus en plus documentés. Selon des rapports de l’Ademe, le secteur numérique contribue à environ 4,4 % de l’empreinte carbone nationale en France, représentant environ 29,5 millions de tonnes équivalent CO2. Cette empreinte provient principalement de l’énergie consumée par les data centers, les réseaux de communication, et les appareils utilisés.
En outre, la production et la fabrication de matériels informatiques constituent environ 80 % de l’empreinte carbone associée au numérique. Les processus d’extraction de matières premières pour fabriquer ces équipements engendrent des pollutions des eaux et des sols. Par conséquent, la prise de conscience des impacts environnementaux de ces infrastructures accompagne la transformation numérique.
Les opportunités offertes par le numérique pour la durabilité
Malgré ses conséquences environnementales, le numérique peut également être un vecteur de solutions durables. Les outils numériques offrent des opportunités sans précédent pour le développement durable et la sensibilisation aux questions environnementales. Par exemple, l’intégration de plateformes d’apprentissage en ligne permet de réduire les déplacements physiques, limitant ainsi l’empreinte carbone liée aux transports.
Les supercalculateurs, par exemple, utilisés dans le domaine de la recherche scientifique, permettent de réaliser des simulations complexes qui contribuent à mieux comprendre les enjeux environnementaux. Cela représente une avancée significative dans les domaines de l’écologie et des sciences environnementales. Des systèmes informatiques puissants peuvent également être employés pour optimiser les process industriels, réduisant ainsi la consommation d’énergie.
Les données du système de l’ESR et les initiatives pour une transition responsable
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont déjà pris certaines initiatives pour appréhender la question de la durabilité dans le cadre de la transition numérique. Des schémas directeurs du numérique sont élaborés afin de planifier une évolution responsable de leurs systèmes d’information. Cela inclut l’intégration de critères de durabilité dans les projets d’innovation.
Certaines universités, comme l’Université de Lille, ont mis en place des démarches visant à mutualiser les moyens de calcul et à développer des infrastructures numériques efficaces. Ces projets visent à maximiser l’efficacité énergétique et à limiter l’impact environnemental en consolidant les ressources au sein d’espaces partagés.
La formation et la sensibilisation aux enjeux écologiques
Une autre dimension importante de cette problématique est l’éducation. L’enseignement supérieur a un rôle clé à jouer dans la formation des étudiants et des chercheurs sur les enjeux écologiques. Plusieurs universités commencent à inclure des modules de cours axés sur les impacts environnementaux du numérique dans leurs programmes, permettant aux étudiants d’acquérir une culture écoresponsable.
À l’Université de Lille, des fresques du numérique sont proposées en licence, tandis que des unités d’enseignement spécifiques sont intégrées aux cursus de master. De plus, des initiatives nationales ont été lancées pour promouvoir l’éducation à la transition écologique pour tous les étudiants, avec des mises à jour à partir de 2025.
L’importance de la recherche et des collaborations pour un avenir durable
La recherche a un rôle fondamental à jouer dans la transition numérique tout en prenant en compte les questions écologiques. Les chercheurs sont appelés à s’unir autour de projets de recherche appliquée qui visent à développer des solutions innovantes pour atténuer l’impact environnemental du numérique. Les GreenDays, par exemple, sont des journées d’échange et de réflexion autour des pratiques numériques responsables, incluant des chercheurs de différentes disciplines.
De surcroît, les collaborations internationales sont essentielles pour faire face aux enjeux environnementaux globaux. La mise en réseau de chercheurs et d’institutions au niveau mondial peut donner lieu à l’émergence d’initiatives communes visant à concilier développement numérique et durabilité, renforçant ainsi l’impact positif de la recherche sur l’environnement.
Les outils numériques au service de l’écoresponsabilité
Pour réduire l’empreinte écologique du numérique, l’adoption d’outils écoresponsables est essentielle. L’utilisation d’équipements informatiques recyclables et écoresponsables doit être privilégiée, tout comme le développement d’applications et de logiciels conçus en respectant des critères d’écoconception. En intégrant ces principes, les établissements d’enseignement supérieur peuvent non seulement réduire leur impact environnemental, mais aussi former des professionnels conscients des enjeux écologiques.
Les institutions doivent également exploiter la puissance des algorithmes pour analyser et modéliser les impacts écologiques. Des plateformes numériques telles que celles fournies par les autorités éducatives rentrent dans cette démarche, offrant des outils pour optimiser les pratiques pédagogiques et de recherche en lien avec l’écologie.
Un cadre législatif pour guider la transformation numérique
Un cadre législatif robuste est nécessaire pour orienter la transition numérique dans le sens de la durabilité. Il est crucial que des lois et régulations soient mises en place pour encourager les institutions à adopter des pratiques durables, tout en limitant les impacts écologiques associés à l’usage numérique. Cela pourrait inclure la mise en place de financements pour le développement d’initiatives numériques écoresponsables, et l’incitation à l’adoption de systèmes éco-conçus.
Parallèlement, des référentiels tels que ceux émanant de l’enseignement supérieur et de la recherche peuvent servir de guide pour les institutions, en leur fournissant des normes et des recommandations pour intégrer l’écologie dans leurs démarches numériques.
Les défis futurs à relever
La transition numérique pose encore de nombreux défis, notamment avec la montée en puissance des intelligences artificielles génératives et leur impact sur l’environnement. Les établissements doivent s’engager à surveiller et à évaluer continuellement l’impact de leurs pratiques numériques sur l’environnement. Par ailleurs, la nécessité de trouver un équilibre entre innovation technologique et conservation des ressources naturelles devient de plus en plus pressante.
Enfin, il est essentiel de favoriser un dialogue entre les différentes parties prenantes — étudiants, chercheurs, décideurs politiques, et acteurs de l’industrie — pour construire un modèle solide de coexistence entre transition numérique et enjeux écologiques.

Témoignages sur la conciliation entre la transition numérique et les enjeux écologiques dans l’enseignement supérieur et la recherche
Jean-Pierre, enseignant-chercheur en sciences de l’environnement : « La transition numérique est incontournable pour moderniser notre enseignement. Cependant, nous devons aussi être conscients de notre empreinte écologique. Il est essentiel de réfléchir à l’utilisation des outils numériques de manière écoresponsable. Par exemple, en privilégiant des solutions de cloud qui utilisent des énergies renouvelables, nous pouvons réduire notre impact tout en offrant un enseignement de qualité. »
Clara, étudiante en informatique : « Je suis passionnée par les nouvelles technologies et leur potentiel pour améliorer l’éducation. Toutefois, il est crucial que notre secteur n’oublie pas son rôle dans la protection de l’environnement. Lorsque j’utilise des outils numériques pour mes projets, je pense toujours à leur impact. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réduction de notre empreinte carbone, et cela inclut l’optimisation de nos pratiques numériques. »
Marc, directeur d’un établissement supérieur : « Notre institution a mis en place des initiatives pour combiner la transition numérique et la durabilité. Nous avons développé des programmes sur l’impact environnemental des technologies, et nous intégrons ces réflexions dans nos cours. En formant nos étudiants à être conscients de ces enjeux, nous agissons non seulement dans l’intérêt de notre établissement, mais aussi pour la société dans son ensemble. »
Sophie, responsable de la recherche dans une université : « Il est impératif de ne pas considérer la transition numérique et les enjeux écologiques comme des forces opposées. Grâce à des pratiques comme la mutualisation des ressources, nous pouvons utiliser les infrastructures numériques de manière plus efficace. Par exemple, en regroupant les calculs dans des data centers optimisés, nous diminuons la consommation énergétique tout en augmentant notre capacité de recherche. »
Thomas, chercheur en développement durable : « En tant que chercheur, je suis toujours en quête de solutions innovantes. La technologie a un rôle fondamental à jouer dans la recherche de ce qui est durable. En utilisant des modèles numériques pour analyser des données complexes sur le climat ou la biodiversité, nous montrons que la technologie peut être un allié dans la lutte pour un avenir plus vert. »







