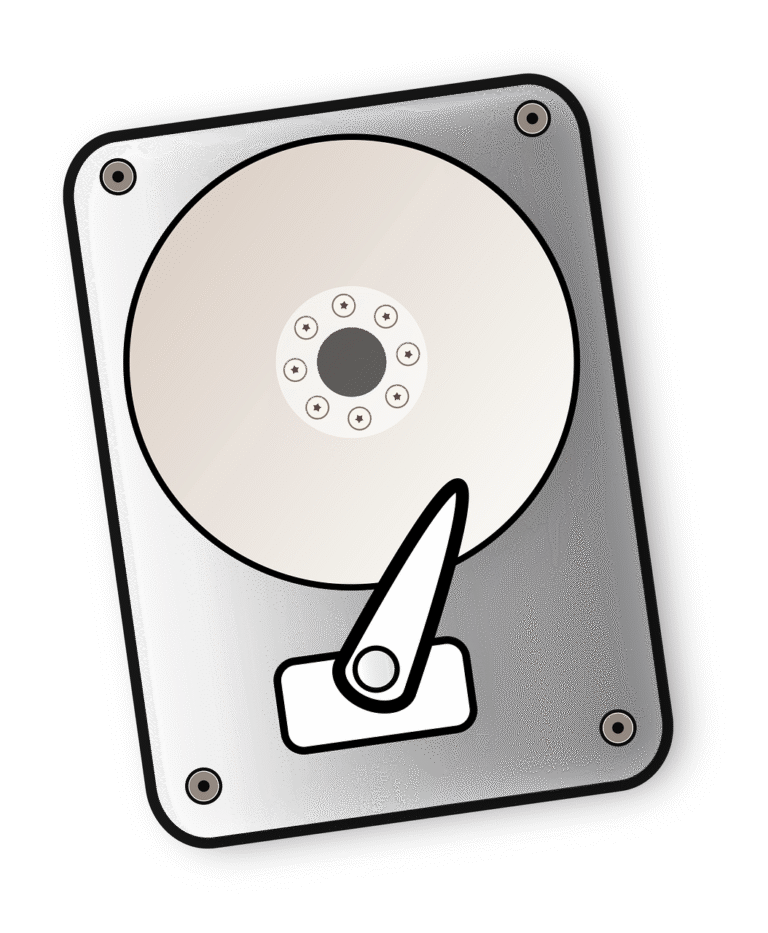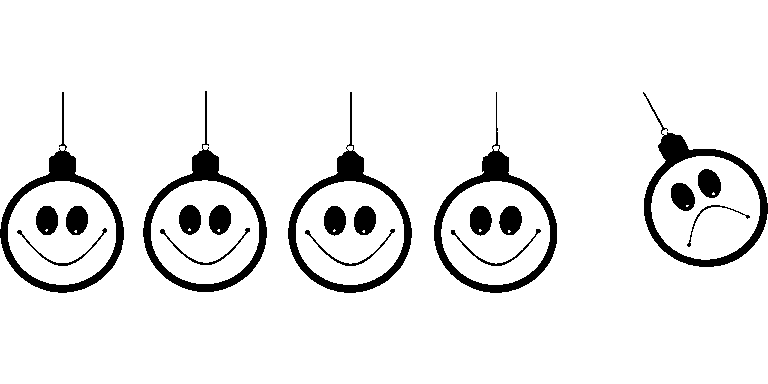|
EN BREF
|
Les forêts, longtemps reconnues comme des puits de carbone, voient leur rôle fragilisé par divers facteurs. En effet, certaines forêts émètent plus de CO₂ qu’elles n’en captent, principalement en raison de la dynamique de croissance et de mortalité des arbres. Des conditions telles que les sécheresses, les maladies et les ravageurs augmentent la mortalité des arbres, réduisant ainsi leur capacité à stocker du carbone. En outre, des événements tels que les feux de forêt et la déforestation entraînent des émissions massives de gaz à effet de serre. Les changements de composition des forêts, qui peuvent ne plus être dominées par des espèces à forte densité de bois, impactent aussi négativement leur bilan carbone. Au fur et à mesure que les conditions climatiques se détériorent, ces tendances pourraient s’accélérer, rendant les forêts encore plus vulnérables à l’émission de CO₂.
Historiquement reconnues pour leur rôle crucial en tant que puits de carbone, les forêts absorbent une partie du dioxid de carbone (CO₂) présent dans l’atmosphère. Toutefois, un phénomène alarmant se dessine : certaines de ces forêts commencent à libérer plus de CO₂ qu’elles n’en captent. Cet article examine les raisons qui motivent cette inversion du bilan carbone et les multiples facteurs qui influencent ce changement, en mettant en lumière les conséquences du changement climatique et les pressions anthropiques.
Les bases du stockage de carbone dans les forêts
Les forêts, à travers le processus de photosynthèse, transforment l’énergie lumineuse et le CO₂ en matière organique. Ce processus permet aux arbres et autres plantes de croître, accumulant du carbone dans leur biomasse. On distingue notamment la biomasse aérienne, qui englobe les troncs, branches et feuilles, et la biomasse souterraine, concentrée dans les racines et les sols. Toutes les forêts, qu’elles soient tropicales, tempérées ou boréales, stockent des quantités significatives de carbone. Cependant, l’équilibre entre la séquestration et l’émission de CO₂ varie considérablement en fonction de divers paramètres environnementaux et anthropiques.
Quand les forêts deviennent émettrices de CO₂
Dans une forêt en équilibre, la croissance des arbres compense leur mortalité, garantissant un bilan neutre en carbone. Cependant, des facteurs externes peuvent perturber cet équilibre, entraînant une situation où les forêts émettent davantage de carbone qu’elles n’en absorbent. Plusieurs situations peuvent entraîner ce phénomène, notamment les feux de forêt, la déforestation et les changements environnementaux extrêmes.
Les perturbations provoquées par le changement climatique
Le changement climatique, en provoquant des sécheresses plus fréquentes et intenses, a un impact négatif sur la croissance des arbres. Les forêts, qui se remettent lentement de ces perturbations, peuvent voir leur capacité à séquestrer du carbone diminuer de manière significative. Un exemple marquant est celui des forêts de l’Amazonie, où une diminution du stockage de carbone a été constatée, mettant en lumière les effets dévastateurs des conditions climatiques extrêmes.
Impact des incendies de forêt
Les feux de forêt, aggravés par les températures élevées et les épisodes de sécheresse, sont une autre source d’émissions de CO₂. Lorsqu’une forêt brûle, une quantité considérable de carbone piégé est relâchée dans l’atmosphère, générant un effet inversé sur son statut de puits de carbone. Les forêts boréales et tempérées, particulièrement touchées par ces phénomènes, commencent à révéler leur potentiel émetteur au fur et à mesure que la fréquence et l’intensité des incendies augmentent.
La mortalité des arbres et la composition des forêts
La dynamique de croissance et de mortalité des arbres joue un rôle essentiel dans le bilan carbone des forêts. L’augmentation de la mortalité due à des facteurs tels que les maladies, les ravageurs et les conditions climatiques extrêmes constitue un défi majeur. Si un nombre accru d’arbres meurt sans être remplacé par des jeunes arbres en pleine croissance, le résultat est une réduction du stockage de carbone.
Diminution de la croissance des arbres
Les nouvelles recherches indiquent une tendance à la baisse de la croissance des arbres dans certaines régions, en particulier en raison de l’augmentation des températures et de la rareté de l’eau. Par exemple, même si les forêts d’Afrique centrale montrent des taux de stockage de carbone relativement constants, celles d’Amazonie ont montré une chute d’environ 30 % entre 2000 et 2010 dans leur capacité à capturer le carbone.
Ces changements de composition sous l’effet du changement climatique
Les changements dans la composition des forêts due à leur adaptation aux nouvelles conditions climatiques ont également un impact sur leur bilan carbone. Des espèces d’arbres moins denses substituant des espèces de plus grande taille peuvent entraîner une diminution significative de la quantité totale de carbone stocké. Ce phénomène ne se limite pas aux régions tropicales, mais est également observable dans les forêts tempérées.
Les forêts tempérées face aux défis du changement climatique
Dans les forêts tempérées, les efforts de gestion forestière ont initialement permis d’augmenter le stockage de carbone de 1990 à 2005. Cependant, face à l’intensification des sécheresses, des tempêtes et d’autres facteurs environnementaux, la mortalité des arbres s’est accentuée, entraînant une diminution générale du stockage de carbone dans cette catégorie de forêts. Les données indiquent une diminution de près de 12 % en Europe entre 2000 et 2010, un chiffre alarmant qui souligne l’urgence d’une intervention.
La situation en France
En France, les forêts métropolitaines, qui absorbaient 63 millions de tonnes de CO₂ annuelles entre 2005 et 2013, ont vu ce chiffre diminuer à 39 millions de tonnes par an entre 2014 et 2022. Cet affaiblissement des capacités d’absorption du CO₂ témoigne de l’influence croissante des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers nationaux.
Les enjeux de la gestion forestière dans un contexte changeant
Préserver les forêts existantes et gérer leurs transitions vers des espèces plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques constitue un enjeu crucial de la gestion forestière actuelle. Le maintien d’un bon stock de carbone passe par une évaluation continue de la dynamique forestière et la mise en place de politiques de reforestation réfléchies.
L’importance de la biodiversité
La biodiversité joue également un rôle fondamental dans le stockage du carbone au sein des forêts. Un écosystème varié se montre souvent plus résilient face aux perturbations et capable de maintenir son équilibre carbone. La protection et reconstitution des habitats naturels sont des actions nécessaires pour renforcer la biodiversité des forêts.
Les forêts, bien qu’elles aient un potentiel immense pour stocker du carbone, sont confrontées à de nombreux défis qui menacent leur rôle en tant que puits de carbone. En comprenant les mécanismes complexes derrière ces transformations, les scientifiques et les gestionnaires des ressources peuvent développer des stratégies d’adaptation plus efficaces pour contrer les effets du climat changeant.
Pour en savoir plus, consultez cet article sur le rôle des forêts dans le bilan carbone global.

Depuis plusieurs années, les forêts, longtemps considérées comme des puits de carbone, voient leur rôle de capture de CO₂ fragilisé. Cette situation n’est pas due à un manque d’efficacité, mais plutôt à un ensemble de facteurs environnementaux et anthropiques. En effet, certaines forêts peuvent émettre davantage de CO₂ qu’elles n’en captent, et cela soulève des inquiétudes quant à leur avenir face au changement climatique.
Un premier témoignage provient des études réalisées en Amazonie, où l’on a constaté une diminution significative de la capacité de stockage de carbone des forêts matures. Ces forêts, autrefois en équilibre, sont désormais affectées par des sécheresses prolongées et plus intenses, entraînant une hausse de la mortalité des arbres et une diminution de leur croissance. Alors qu’elles stockaient solidement le carbone dans leurs troncs et leur biomasse, la dynamique a changé, faisant passer certaines forêts d’une situation de stockage à une situation d’émettrice de CO₂.
De plus, dans les forêts boréales, un phénomène similaire s’observe : les feux de forêt et les perturbations causées par des facteurs humains aggravent les émissions de gaz à effet de serre. En effet, ces incendies non seulement libèrent du carbone déjà stocké, mais affaiblissent également la résilience de l’écosystème, ralentissant la régénération des forêts et compromettant leur capacité à se retransformer en puits de carbone.
Par ailleurs, les changements de composition des forêts jouent un rôle critique. La diversité d’espèces végétales influe sur le bilan carbone : lorsque des arbres de grande taille sont remplacés par des espèces plus petites et moins denses, la capacité à stocker du carbone diminue. Ce phénomène a été observé dans plusieurs écosystèmes tropicaux, où la transition vers des espèces moins adaptées au carbone se traduit par une baisse des réserves de carbone.
Enfin, les activités humaines telles que la déforestation et l’agriculture contribuent également à un bilan carbone défavorable. La conversion de forêts en terres cultivées ou en zones urbaines libère d’énormes quantités de CO₂ dans l’atmosphère, tout en réduisant la capacité globale des paysages forestiers à absorber le carbone. Face à cette réalité, une prise de conscience collective s’impose pour protéger et régénérer ces écosystèmes vitaux.