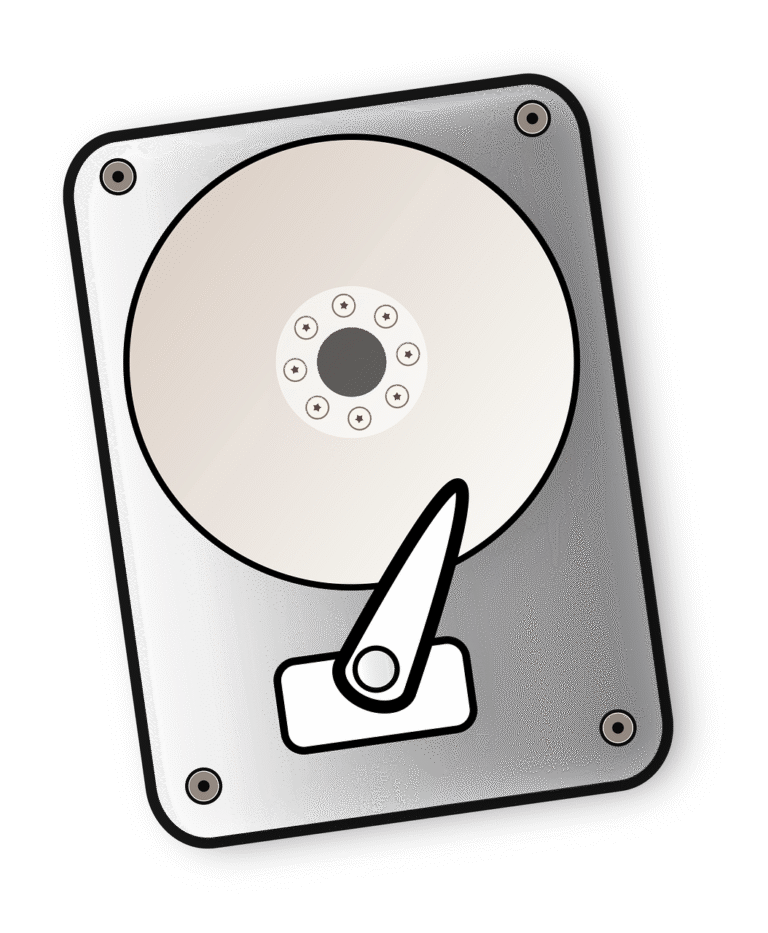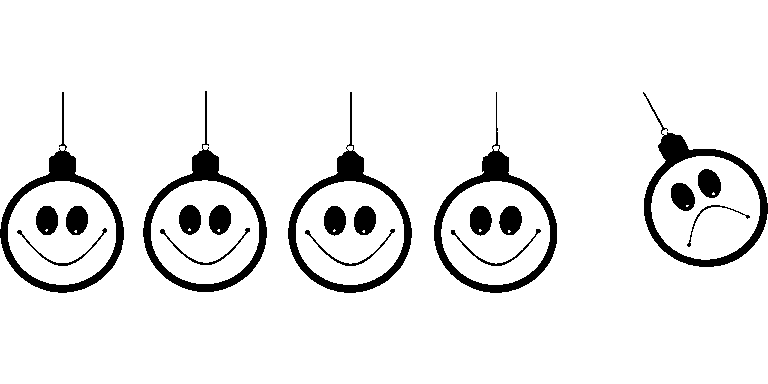|
EN BREF
|
La forêt amazonienne brésilienne a subi un déclin alarmant au cours de la dernière décennie, en raison d’un affaiblissement des politiques de protection de l’environnement depuis 2019. Les analyses montrent que les dégradations forestières, causées par des activités humaines et des événements climatiques, ont entraîné des émissions de carbone supérieures à celles générées par la déforestation elle-même. Entre 2010 et 2019, les pertes de carbone liées à ces dégradations ont été trois fois plus importantes que celles dues à la déforestation. Ce constat souligne la nécessité d’intégrer les dégradations forestières dans les politiques environnementales afin de préserver la capacité de la forêt à stocker du carbone, essentielle pour atténuer le changement climatique.
La forêt amazonienne, souvent qualifiée de « poumon de la planète », est confrontée à des menaces environnementales croissantes qui impactent non seulement l’écosystème local, mais également le climat mondial. Au cours de la dernière décennie, les politiques de protection de l’environnement au Brésil ont subi de profonds changements, semant le doute sur la capacité de cette forêt à absorber le carbone. Cet article explore les implications de ces menaces environnementales et fournit un bilan des émissions de carbone générées par la déforestation et la dégradation de la forêt au cours des dix dernières années.
Une décennie de changements politiques et environnementaux
Depuis 2010, la forêt amazonienne brésilienne a été le théâtre de politiques environnementales fluctuantes. En 2019, le changement de gouvernement a marqué un tournant décisif dans la protection des écosystèmes. La réduction des investissements dans la conservation de l’environnement a conduit à une augmentation de la déforestation, comme le montre l’analyse des données satellite. À cette époque, la déforestation a atteint un niveau alarmant de 3,9 millions d’hectares, soit 30 % de plus que lors de la sécheresse d’El Niño en 2015. Malgré la difficulté de suivre les dégradations causées par des événements climatiques ou des coupes ponctuelles d’arbres, il est essentiel de les prendre en compte pour évaluer la santé du carbone dans la forêt.
Déforestation et dégradations forestières
La déforestation de la forêt amazonienne représente un enjeu ecologique majeur. Au-delà de la simple coupe d’arbres, de nombreux événements contribuent à la dégradation des forêts. Ces dégradations incluent des coupes sélectives, des incendies, des sécheresses et d’autres interventions humaines qui affaiblissent la structure même de la forêt. Elles constituent un facteur aggravant, provoquant une mortalité accrue des arbres et une flexibilité réduite à d’autres sources de stress environnementaux.
Les dégradations, en effet, ont un impact sur les stocks de carbone, qui dépassent en effet les pertes liées à la simple déforestation. Les études mettent en avant le fait que durant la période 2010-2019, les pertes de carbone dues à ces dégradations sont trois fois plus importantes que celles engendrées par la déforestation proprement dite. Ce constat souligne l’importance d’une démarche plus nuancée vers la conservation.
L’impact climatique des dégradations forestières
Les conséquences des dégradations des forêts ne se limitent pas à la perte de biomasse arbustive. La déforestation et les dégradations entraînent une augmentation des émissions de carbone, amplifiant ainsi le changement climatique. Une étude récente montre que la biomasse forestière de l’Amazonie brésilienne a rejeté plus de carbone qu’elle n’en a absorbé au cours de cette période, reflétant la détérioration de l’état de la forêt.
Plus précisément, il a été constaté que les pertes annuelles de carbone en 2015, lors d’une sécheresse extrême, ont été trois fois supérieures à celles observées en 2019. Ce choc en termes de biomasse et d’émissions de carbone témoigne d’un climat de plus en plus instable, agissant sur la santé des écosystèmes forestiers.
Les méthodes d’évaluation des émissions de carbone
Pour mesurer efficacement l’impact des dégradations et de la déforestation, les chercheurs se sont appuyés sur des méthodes innovantes. L’indice satellitaire de végétation L-VOD, développé par des chercheurs de l’INRAE, du CEA et du CNRS, a offert une nouvelle perspective sur l’évaluation des stocks de carbone. Cet indice permet de suivre les dégradations forestières, hormis celles ayant entraîné des pertes visibles dans la couverture forestière.
Ces techniques d’analyse par satellite, combinées à des modèles de climat et de végétation, ont permis de rendre compte des variations des stocks de carbone au fil du temps, donnant aux chercheurs des outils fiables pour quantifier les conséquences des menaces environnementales sur la forêt brésilienne.
Dégradations et effets économiques
Les conséquences des dégradations forestières en Amazonie ne se limitent pas à des considérations écologiques. Elles ont également des répercussions économiques significatives. La déforestation et les dégradations entraînent des pertes de services écosystémiques essentiels, tels que la régulation climatique, la purification de l’eau et la conservation de la biodiversité.
Les communautés locales, souvent dépendantes des ressources forestières, se retrouvent alors dans une situation précaire. La perte d’arbres signifie une diminution des produits forestiers, allant des médicaments traditionnels à la nourriture. Cela souligne l’importance d’une gestion durable des ressources forestières pour la préservation des moyens de subsistance de nombreuses populations.
Vers des solutions durables
Il est crucial d’adopter des pratiques de gestion forestière durables et de renforcer les politiques de protection de l’environnement. Les dégradations de la forêt doivent être prises en compte et traitées avec sérieux pour élaborer des stratégies efficaces visant à atténuer les impacts du changement climatique.
Des initiatives telles que des plantations d’arbres, la reforestation, et la promotion de l’agroforesterie pourraient contribuer à restaurer la biodiversité tout en renforçant la résilience aux menaces environnementales. De plus, conditionner les politiques environnementales à des programmes de sensibilisation et d’éducation se révèle essentiel pour renforcer l’engagement des populations locales dans la préservation de leur environnement.
Engagements internationaux et collaboration
Sur le plan international, la collaboration entre les pays est de plus en plus nécessaire pour faire face aux défis environnementaux en Amazonie. Des engagements à réduire les émissions de carbone doivent être pris à l’échelle globale, incluant des dispositifs de financement et des échanges technologiques. Le soutien aux pays en développement pour mettre en œuvre des stratégies de conservation peut avoir un impact significatif à long terme.
De plus, les alliances avec des ONG et des acteurs du secteur privé peuvent jouer un rôle clé dans la préservation de l’Amazonie. Ces collaborations permettent de partager des ressources, des expertises et des innovations qui propulsent vers un futur durable. Cependant, cette dynamique dépend aussi d’une volonté politique forte pour faire respecter les lois environnementales en place.
Les menaces qui pèsent sur la forêt amazonienne brésilienne nécessitent une attention immédiate et collective. L’accélération de la déforestation, conjuguée à des pratiques non durables et au changement climatique, fragilise non seulement l’écosystème local, mais aussi la stabilité climatique de la planète. En prenant conscience de ces enjeux et en agissant de manière proactive, il est possible d’envisager un avenir où la forêt amazonienne peut continuer à jouer son rôle crucial dans l’équilibre écologique et le stockage de carbone.

Depuis plus de dix ans, la forêt amazonienne brésilienne subit des menaces environnementales croissantes, exacerbées par des politiques de protection de l’environnement de plus en plus faibles. Cette situation a des conséquences dramatiques sur les écosystèmes et les émissions de carbone dans la région. Les études récentes indiquent qu’en dépit des gains temporaires, la forêt rejette désormais plus de carbone qu’elle n’en absorbe, ce qui menace gravement l’équilibre climatique mondial.
L’augmentation de la déforestation en 2019, avec 3,9 millions d’hectares détruits, a été un tournant important. Ce chiffre représente une hausse de 30 % par rapport à la période de sécheresse extrême d’El Niño en 2015, et presque quatre fois celle observée en 2017 et 2018. Toutefois, l’analyse des stocks de carbone révèle que les pertes en 2015, liées aux dégradations causées par les incendies et la mortalité des arbres, ont été trois fois supérieures à celles de 2019. Cette situation illustre à quel point les conditions climatiques extrêmes peuvent amplifier les résultats dévastateurs pour la forêt.
Les données alimentent les préoccupations concernant l’impact des dégradations forestières, qui sont souvent négligées. En effet, les activités d’exploitation, les coupes ponctuelles d’arbres et des événements climatiques tels que des sécheresses altèrent gravement la santé de la forêt. Plus alarmant encore, les dégradations causées par ces facteurs ont un impact trois fois supérieur à celui de la déforestation. Cela constitue un signal fort pour les décideurs, qui doivent intégrer ces éléments dans leurs stratégies de conservation.
Les résultats des recherches montrent aussi une inversion de la tendance historique des stocks de carbone en Amazonie. La période 2010-2019 a été marquée par des pertes nettes de biomasse forestière, réduisant ainsi la capacité de la forêt à stocker le carbone, élément crucial dans la lutte contre le changement climatique. Les chercheurs appellent à une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver non seulement la superficie des forêts, mais également leur intégrité et leur capacité de régénération.
En somme, la situation de la forêt amazonienne est préoccupante. Les pertes de carbone liées aux dégradations illustrent l’urgence d’adopter des politiques environnementales plus robustes, prenant en compte l’impact cumulé des menaces environnementales sur l’écosystème. Une action immédiate est nécessaire pour protéger cette ressource vitale, qui joue un rôle clé dans la régulation du climat à l’échelle planétaire.