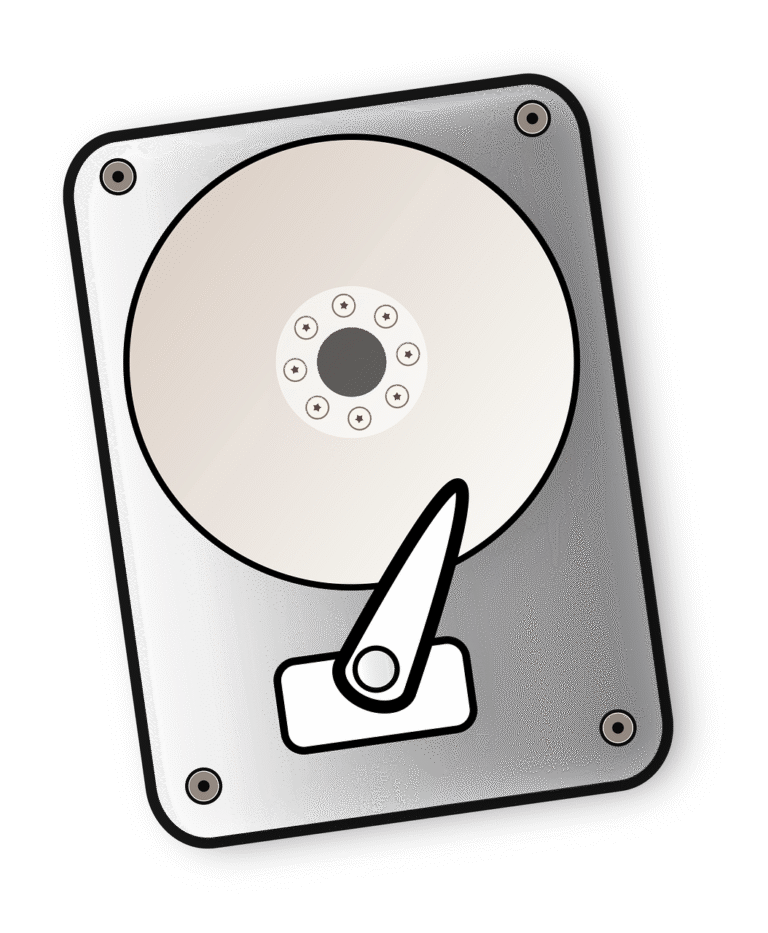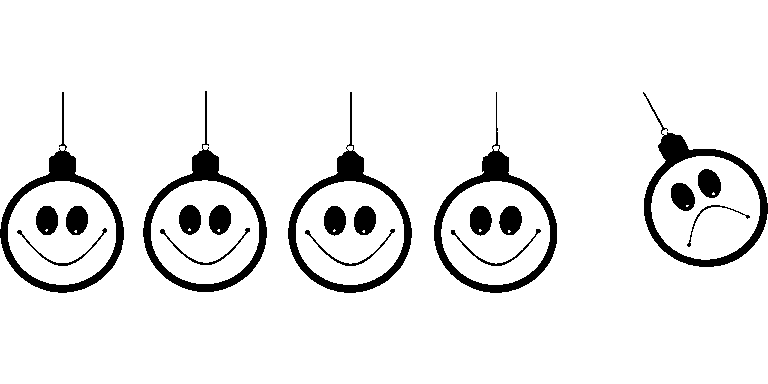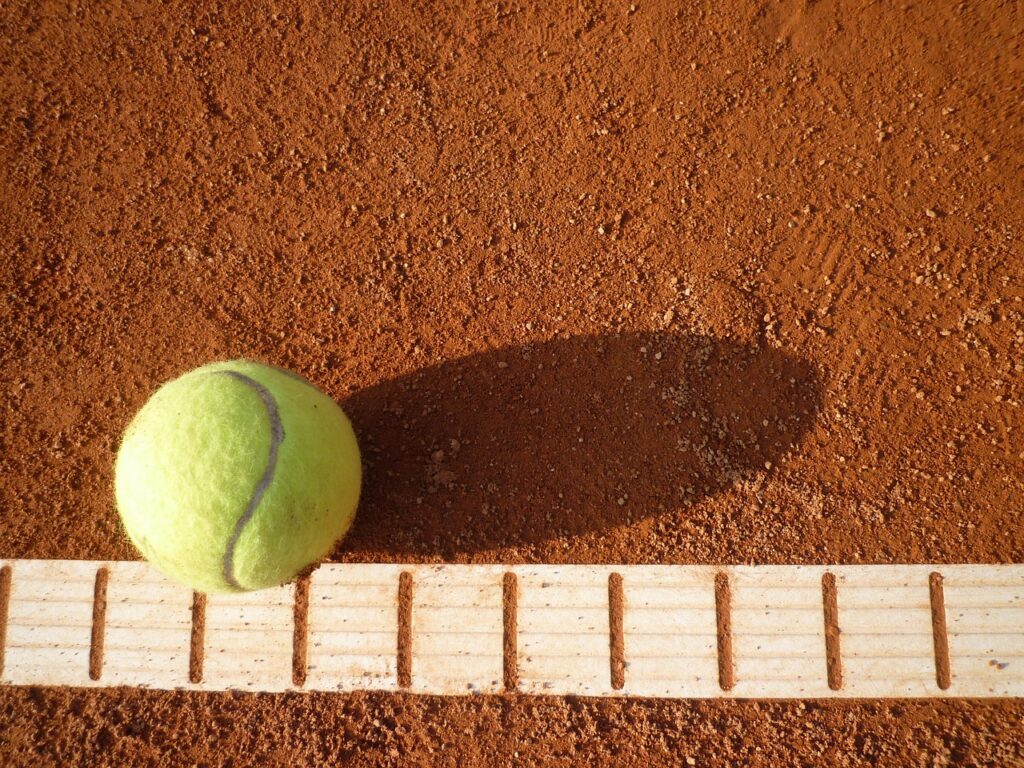
|
EN BREF
|
Dans un monde confronté à l’urgence écologique, les acteurs du tennis commencent à réagir, bien que leurs efforts demeurent fragmentés et variés. L’ATP a publié son premier rapport de développement durable en 2024, affichant un bilan carbone de 6.381 tonnes de CO2 pour 2023, avec un objectif de réduire ses émissions de 50% d’ici 2030. En revanche, la WTA privilégie le dialogue plutôt que les rapports chiffrés, encourageant des initiatives écologiques lors des tournois. La Fédération internationale de tennis (ITF) et les organisations des Grands Chelems s’engagent également, mais l’absence de cohérence dans la gouvernance complique les actions. Chaque entité semble avancer séparément, presque à l’image d’une mosaïque, face aux défis climatiques.
Le monde du tennis est en train de prendre conscience de l’urgence écologique, mais les actions entreprises demeurent souvent isolées et fragmentées. La prise de conscience des enjeux climatiques a conduit à des initiatives variées au sein des organismes de tennis, allant des rapports sur les émissions de gaz à effet de serre aux programmes d’écoresponsabilité. Toutefois, il reste encore un long chemin à parcourir pour une mobilisation collective et cohérente face au changement climatique. Cet article examine les efforts des principales instances du tennis, notamment l’ATP, la WTA, l’ITF et les tournois du Grand Chelem, pour évaluer leur impact environnemental et leurs récentes initiatives.
L’ATP et son bilan carbone
Sur le circuit masculin, l’Association des joueurs de tennis professionnels, connue sous le nom d’ATP, a publié en 2024 son premier rapport sur le développement durable. Ce document représente une avancée notable, car il inclut pour la première fois une évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par l’organisation. Si l’ATP exclut les émissions considérables dues aux déplacements de milliers de joueurs lors des tournois internationaux, elle revendiquerait un bilan carbone de 6.381 tonnes équivalent CO2 pour l’année 2023, un chiffre en forte hausse de 58% par rapport à l’année précédente.
La fédération affiche des objectifs ambitieux, aspirant à réduire ses émissions de 50% d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2022 et à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2040. En 2023, l’ATP a également mis en œuvre le « Carbon Tracker », une application innovante permettant aux joueurs de suivre et compenser les émissions de leurs voyages en investissant dans des projets écologiques. Cependant, le nombre de joueurs utilisant cette application a chuté, passant de 201 à un peu plus de 100 l’année suivante.
La WTA et ses directives volontaristes
Contrairement à son homologue masculin, la WTA (Women’s Tennis Association) n’a pas encore pris l’initiative de publier un rapport de durabilité ni d’évaluer ses propres émissions. Elle préfère favoriser le dialogue et encourager un changement graduel plutôt que d’imposer des règlements stricts. Cela inclut des recommandations aux tournois pour diminuer l’utilisation de plastique à usage unique, installer des bornes de recharge pour véhicules électriques, et redistribuer les repas non consommés.
Les joueuses sont également incitées à opter pour des gourdes réutilisables au lieu de bouteilles en plastique et à choisir des hôtels qui n’effectuent pas des nettoyages quotidiens des chambres pour réduire leur empreinte écologique. Un exemple significatif est le tournoi WTA 500 de Strasbourg, qui, depuis 2009, mesure régulièrement ses émissions et encourage ses spectateurs à utiliser des transports écologiques.
L’ITF se penche sur la durabilité
La Fédération internationale de tennis (ITF), responsable de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup, a publié en 2022 un premier bilan carbone pour l’année 2021. Cependant, ce bilan ne prenait pas en compte les émissions générées par les compétitions nationales. Les données de 2023 et 2024 ont été mesurées, mais l’ITF a choisi de ne pas les divulguer, en se déclarant toujours « dans une phase d’apprentissage ».
En parallèle, l’ITF a établi un groupe de travail sur la durabilité des équipements, composé de dix fabricants sportifs ainsi que des fédérations française (FFT) et américaine (USTA). Cette collaboration vise à développer des modèles de balles plus durables et à travailler sur le recyclage des matériaux utilisés, comme les fibres de carbone présentes dans les raquettes de tennis.
Les grands tournois du Grand Chelem et leur engagement
Les quatre majeurs du tennis, à savoir l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open, ont unanimement adhéré en 2019 au « Cadre de l’action climatique dans le sport », une initiative soutenue par l’ONU. Cet engagement les pousse à prendre des initiatives pour réduire leur empreinte écologique et éduquer leurs participants et spectateurs sur l’importance de l’action climatique. Leur objectif est de promouvoir une responsabilité environnementale, diminuer leur impact global, et encourager des pratiques de consommation durable.
Néanmoins, la responsable de la RSE à la FFT, Claire Hallé, souligne que l’organisation du tennis est complexe. Le partage des responsabilités entre plusieurs échelons et instances rend les décisions moins fluides et immédiates que si un seul organisme pilotait la situation. À l’heure actuelle, tous les acteurs du tennis mondial continuent d’échanger des idées et meilleures pratiques concernant la durabilité.
Des initiatives écologiques naissantes au sein des fédérations et clubs
La Fédération française de tennis (FFT) œuvre depuis près de quinze ans pour l’environnement à travers de nombreuses initiatives telles que l’Opération Balle Jaune ou la Fresque écologique du tennis. Cette dernière représente un outil de sensibilisation précieux pour former les clubs sur la transition écologique et initier une réflexion collective.
Les initiatives que la FFT met en place visent à encadrer et à accompagner les clubs à travers des actions concrètes, comme l’amélioration de la gestion des déchets et l’encouragement à des pratiques durables. Le tournoi de Roland-Garros a pour exemple intégré la Fresque écologique dans son programme d’activités, permettant ainsi aux visiteurs de mieux comprendre l’impact du tennis sur l’environnement.
Vision critique sur les actions entreprises
Malgré ces efforts, il est impératif de reconnaître que les actions des différentes instances restent disparates et manquent souvent d’une vision d’ensemble. Les initiatives prennent souvent la forme d’actions individuelles, sans création d’une politique cohérente et intégrée. La fragmentation des méthodes et des objectifs peut nuire à une efficacité optimale, et il serait bénéfique de voir une coordination plus stricte entre toutes les parties prenantes du tennis.
Il convient de faire des bilan carbones un véritable outil d’analyse pour impulser des changements significatifs. Bien que quelques fédérations aient déjà initié leur démarche, la majorité d’entre elles n’ont encore que des objectifs peu mesurables, ce qui réduit la portée de leurs actions. De plus, les solutions comme le recyclage ou l’usage de matériaux durables doivent rentrer dans la norme pour être réellement efficaces.
Perspectives d’amélioration et d’évolution
Pour répondre efficacement à l’urgence écologique, il est crucial que les instances du tennis adoptent une stratégie collective. Cela passerait par l’établissement de standards globaux concernant l’évaluation et la réduction de l’empreinte carbone. Les récentes initiatives exemplaires de certains tournois devraient inspirer d’autres compétitions à se lancer dans des projets de durabilité similaires.
Par ailleurs, la réflexion autour des transports est essentielle. Les déplacements fréquents des joueurs et des équipes représentent un défi de taille. L’adoption de pratiques de voyage plus durables, ainsi que la mise en place de solutions de compensation efficace, pourraient sensiblement réduire l’impact du circuit professionnel sur l’environnement.
Conclusion ouverte sur les enjeux globaux
Le tennis, comme beaucoup d’autres disciplines sportives, doit affronter le défi du changement climatique avec des actions concrètes et un directif clair. Les acteurs du tennis mondial ont l’opportunité de se rassembler et d’agir ensemble pour réduire leur empreinte écologique. En établissant un cadre plus structuré et en adoptant des solutions durables à long terme, le tennis pourrait devenir un modèle d’écoresponsabilité dans le monde du sport.

Au sein du tennis mondial, des initiatives en matière d’environnement commencent à émerger, mais elles restent encore trop souvent éparpillées et dénuées de coordination. Les bilans carbone et la compensation des émissions sont des sujets de préoccupation croissante parmi les différents acteurs du sport. Chaque organisation semble se battre dans son coin pour répondre à des enjeux climatiques pressants.
L’ATP, par exemple, a présenté son premier rapport sur le développement durable, révélant un bilan carbone de 6.381 tonnes de CO2 pour l’année 2023. Avec un objectif de réduction de 50% de ses émissions d’ici 2030, l’ATP semble déterminée, mais la question reste de savoir si cette détermination sera suffisante face à l’urgence écologique.
Dans le camp féminin, la WTA adopte une approche différente. Si elle n’a pas encore publié de rapport chiffré, elle privilégie le dialogue et l’incitation plutôt que l’imposition de mesures. Des recommandations visant à réduire l’usage du plastique et à adopter des pratiques écoresponsables sont disséminées. Les tournois sont encouragés à prendre des mesures concrètes, mais l’absence d’objectifs mesurables laisse planer un doute sur l’efficacité de cette stratégie.
De son côté, la Fédération Internationale de Tennis (ITF) a commencé à établir son bilan carbone, mais l’organisation reconnaît qu’elle est encore dans une phase d’apprentissage. Les efforts pour renforcer la durabilité des équipements impliquent la collaboration avec les grands fabricants d’équipements sportifs, mais ces actions semblent sporadiques et manquent d’une vision à long terme.
Les quatre tournois du Grand Chelem s’engagent également à réduire leur empreinte écologique en adhérant au “Cadre de l’action climatique dans le sport”. S’ils affichent une volonté collective, le manque de coordination entre ces événements met en lumière une réalité : sans un effort centralisé, chaque initiative risque de rester une action isolée.
En France, la Fédération Française de Tennis s’illustre avec la Fresque Écologique du Tennis, un outil destiné à sensibiliser les clubs. Cette initiative témoigne d’un effort sincère pour engager les acteurs à réfléchir sur leur impact environnemental. Cependant, le défi demeure : il est crucial de passer de la sensibilisation à l’action réelle dans le but d’opérer une transformation durable au sein du sport.